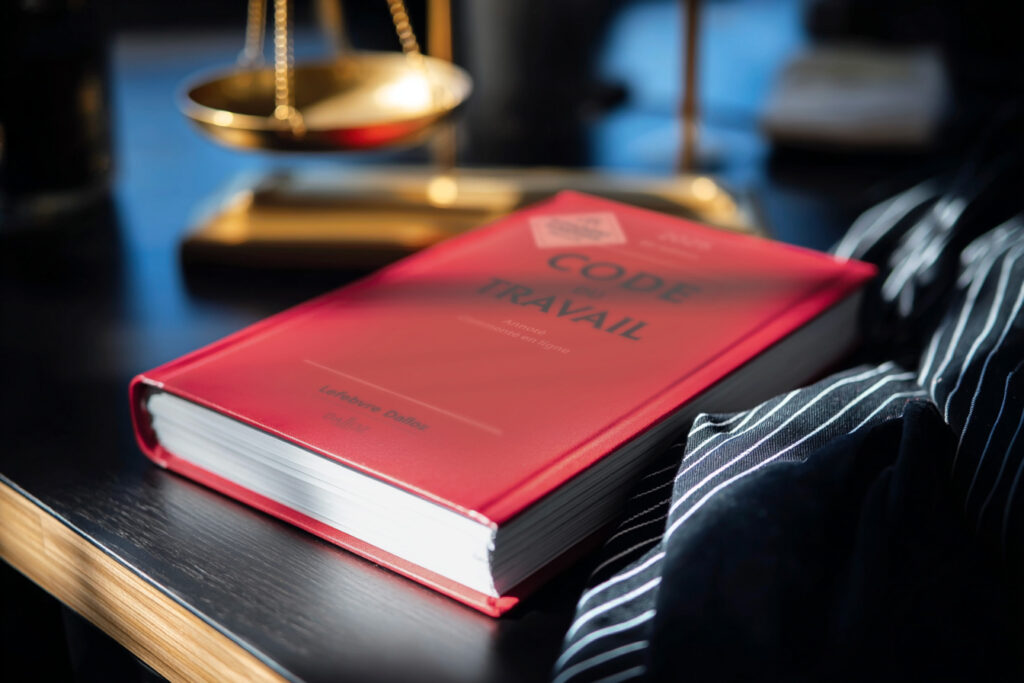L’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 10 décembre 2025 dans l’affaire Pronovias France illustre, de manière saisissante, l’asymétrie croissante des moyens dont disposent respectivement le salarié et l’employeur dans le contentieux du travail. Si le titre de cette note peut paraître provocateur, il traduit une réalité juridique que tout employeur doit désormais intégrer dans sa gestion des ressources humaines.

Les faits : une fraude caractérisée, un employeur désarmé
Mme T., engagée en qualité de vendeuse par la société Pronovias France le 23 juillet 2012, est placée en arrêt maladie consécutif à un accident du travail. Le 6 juillet 2018, le médecin du travail la déclare apte à la reprise lors de la visite médicale réglementaire. La salariée exprime son désaccord avec cet avis auprès de sa hiérarchie.
Quelques jours plus tard, le 23 juillet 2018, elle transmet à son employeur un arrêt de travail antidaté au 20 juillet 2018. L’employeur, soucieux de remplir ses obligations déclaratives auprès de la Sécurité sociale, contacte le médecin traitant pour vérifier les dates. C’est alors qu’il découvre la supercherie.
Pour obtenir cet arrêt de travail, la salariée avait déclaré à son médecin traitant qu’elle exerçait la profession de couturière et qu’elle ne pouvait, en raison de sa pathologie, utiliser son pouce pour coudre. Or, Mme T. n’était pas couturière. Elle était vendeuse. Ce n’était qu’occasionnellement, et de manière tout à fait marginale, qu’elle pouvait être amenée à poser des épingles dans le cadre de ses fonctions.
Le mensonge était donc double. Mensonge sur la nature même de l’emploi occupé. Mensonge sur les contraintes physiques qu’il impliquait. La salariée avait délibérément induit son médecin traitant en erreur pour obtenir un certificat médical de complaisance, dans le but manifeste de contourner l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail.
Fort de ces éléments établissant une manœuvre frauduleuse, l’employeur procède au licenciement pour cause réelle et sérieuse, reprochant notamment à la salariée d’avoir « indiqué à son médecin traitant qu’étant couturière elle ne pouvait exécuter ses tâches habituelles et utiliser son pouce pour coudre, ce qui était inexact ».
La sanction paraît non seulement légitime, mais proportionnée : la salariée avait obtenu un arrêt de travail par des déclarations mensongères, dans un contexte de contestation déloyale d’un avis médical défavorable à ses prétentions.
La Cour de cassation en décide autrement.
La sanction : nullité du licenciement et réintégration
La Haute juridiction approuve la Cour d’appel de Paris d’avoir prononcé la nullité du licenciement. Le raisonnement est implacable : en contactant le médecin traitant de la salariée, l’employeur a violé le secret médical et, par voie de conséquence, porté atteinte au droit au respect de la vie privée, qualifié de liberté fondamentale. Le licenciement fondé, même partiellement, sur des informations ainsi obtenues est nul de plein droit.
Peu importe que ces informations aient révélé une fraude caractérisée. Peu importe que la salariée ait menti sur son métier pour obtenir un arrêt de travail injustifié. Peu importe que l’employeur ait agi dans un souci de vérification légitime. La source de l’information est illicite ; son utilisation l’est donc également ; le licenciement est nul.
La Cour précise que le secret médical couvre « tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Les propos tenus par la salariée lors de la consultation, fussent-ils mensongers, relèvent de ce secret. L’objet de l’échange est donc indifférent : que l’employeur ait voulu vérifier une simple date ou obtenir des informations médicales substantielles, la violation est constituée.
Quant aux voies de recours dont disposait l’employeur, la Cour les énumère avec une certaine sécheresse : saisir la CPAM pour solliciter un contrôle ou s’adresser au médecin du travail. Rien d’autre.
L’impasse pratique : des recours théoriques
Examinons la pertinence de ces alternatives au regard des faits de l’espèce.
Le contrôle par la CPAM suppose que l’organisme accepte de diligenter une vérification, ce qui n’est nullement garanti et implique des délais incompatibles avec les impératifs de gestion. Au surplus, ce contrôle porte sur le bien-fondé médical de l’arrêt au regard de l’état de santé du salarié, non sur la sincérité des déclarations faites au médecin. La CPAM n’aurait pas vérifié si Mme T. était réellement couturière ou vendeuse.
Le médecin du travail, quant à lui, s’était déjà prononcé : il avait rendu un avis d’aptitude. C’est précisément cet avis que la salariée cherchait à contourner en obtenant un arrêt de son médecin traitant sur la base de fausses déclarations. Le médecin du travail n’a ni compétence ni vocation à contrôler les certificats délivrés par les médecins de ville, et encore moins à vérifier si le salarié a menti sur la nature de son poste.
L’employeur se trouve donc dans une situation kafkaïenne : il constate une fraude manifeste, dispose d’éléments établissant que la salariée a menti sur son métier pour obtenir un arrêt de travail de complaisance, mais ne peut ni utiliser ces éléments ni les vérifier par des voies légales efficaces.
Le paradoxe : le mensonge protégé par le secret médical
L’enseignement le plus troublant de cet arrêt réside dans l’extension de la protection du secret médical aux déclarations mensongères du patient.
Mme T. a affirmé être couturière alors qu’elle était vendeuse. Cette affirmation était objectivement fausse. Elle visait à tromper le médecin traitant pour obtenir un certificat injustifié. Pourtant, parce qu’elle a été formulée dans le cadre d’une consultation médicale, elle bénéficie de la protection absolue du secret professionnel.
L’employeur qui découvre ce mensonge ne peut l’invoquer. Le médecin qui l’a reçu ne peut le révéler. Le salarié qui l’a proféré est intouchable.
La conséquence pratique est considérable : un salarié peut désormais obtenir un arrêt de travail en présentant à son médecin traitant une version déformée, voire entièrement fictive, de ses conditions de travail, et bénéficier d’une immunité totale dès lors que l’employeur ne pourra établir la fraude que par des moyens portant atteinte au secret médical.
Les enseignements à tirer
Cette décision appelle plusieurs observations pratiques.
En premier lieu, l’employeur doit bannir tout contact direct avec le médecin traitant d’un salarié, quelle qu’en soit la raison invoquée, et quand bien même il suspecterait une fraude caractérisée. L’argument des obligations déclaratives ne constitue pas un motif légitime au sens de la jurisprudence.
En deuxième lieu, face à un arrêt de travail suspect, les seules options demeurent la contre-visite médicale patronale et la demande de contrôle auprès de la CPAM. Ces procédures ne permettront pas d’établir que le salarié a menti sur la nature de son poste, mais elles constituent le cadre légal exclusif.
En troisième lieu, l’employeur doit veiller à ce que les fiches de poste et contrats de travail décrivent avec précision les fonctions réellement exercées. En cas de contentieux, ces documents pourront au moins établir la réalité des tâches confiées au salarié, même si l’employeur ne pourra pas démontrer ce que le salarié a déclaré à son médecin.
Une protection absolue du mensonge
L’arrêt du 10 décembre 2025 consacre, qu’on le veuille ou non, une forme de protection du mensonge dès lors qu’il s’inscrit dans le cadre d’une consultation médicale.
La salariée qui déclare être couturière alors qu’elle est vendeuse, qui invoque des contraintes physiques imaginaires pour obtenir un arrêt de travail, qui utilise ce certificat pour contourner un avis d’aptitude du médecin du travail, bénéficie d’une immunité absolue. L’employeur qui découvre la supercherie et commet l’erreur de vouloir l’établir voit son licenciement annulé et doit réintégrer la salariée avec rappel de salaires.
La morale de cette affaire est cruelle : dans le contentieux prud’homal contemporain, mieux vaut parfois fermer les yeux sur une fraude que de chercher à l’établir par des moyens qui, pour paraître naturels, n’en sont pas moins prohibés.